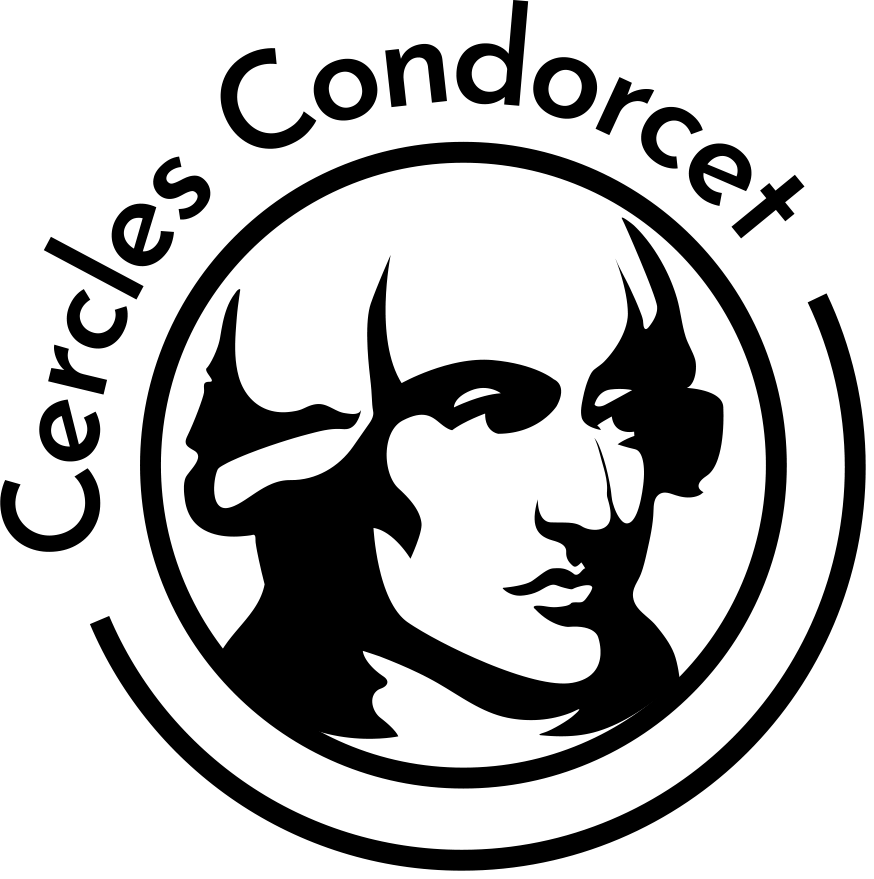Comment peut-on être Européen ?
Union européenne. Qu’est-ce que le dialogue Article 17 ?
Sans être laïques les Communautés européennes n’étaient pas concernées par les relations entre les institutions et les religions. Ni le Traité de la Communauté du charbon et de l’acier (CECA) en 1952, ni le Traité de la Communauté économique européenne (CEE) de Rome en 1957 n’abordaient cette question. S’agissant de traités internationaux portant sur des problèmes de relations économiques, cela était logique : les relations État/Églises relevaient de la seule responsabilité des États membres.
L’institutionnalisation des Églises dans les textes de l’Union européenne.

Article 17 dialogue on Housing in the EU: Strategies for a Europe that Supports People, Families and Younger GenerationsArticle
Le Traité de L’Union européenne (TUE) de Lisbonne, en vigueur depuis décembre 2009, prévoit dans son article 17 un dialogue entre les institutions de l’UE et les Églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles : « Article 17
1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. » Ce dialogue est appelé dans le jargon communautaire « dialogue article 17 ».
Cet article est le résultat d’un long processus dans la construction de l’Union européenne. Le courant politique chrétien-démocrate a joué un rôle déterminant dans la construction européenne dès son origine. Très vite, des personnalités de ce courant s’organisent au sein des institutions des communautés européennes et y jouent un rôle politique déterminant, mais les traités d’origine (CECA et CEE) ne disent rien sur les relations entre les Églises et les institutions. C’est une compétence qui relève exclusivement des États membres.
Cependant, le Traité d’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes en 1981 reconnaît les dispositions spécifiques du Mont Athos incluses dans la Constitution grecque (article 105). La Grèce en avait fait une condition de son adhésion, les neuf États membres des CEE à l’époque souhaitant conforter la démocratie en Grèce qui sortait d’une dictature militaire dure ont accepté.
Le Traité de Maastricht, en 1992, crée l’Union européenne avec des prérogatives politiques débordant les seules questions économiques, même si ces dernières demeurent dominantes. Notamment, il crée une citoyenneté européenne, fait référence à et respecte la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, crée une amorce de politique étrangère de l’UE.
Cette « politisation » élargit le champ de l’UE. Une déclaration N°11 annexée au Traité d’Amsterdam en 1997 précise : « Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles- L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »
L’offensive institutionnelle des religions pour obtenir leur reconnaissance dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, afin d’avoir une reconnaissance institutionnelle pour peser sur les politiques communautaires, s’accentua avec les deux Conventions qui élaborèrent l’une, la Charte des droits fondamentaux de l’UE en 2000 et l’autre, le projet de « Constitution de l’UE » en 2002/2003 qui sera caduque suite aux référendums négatifs en France et aux Pays-Bas en 2005.
Pour la Charte, le débat porta sur l’introduction de « racines chrétiennes de l’Europe » dans le préambule sur demande notamment de représentants de l’Allemagne. La rédaction finale du préambule est : « de son patrimoine spirituel et moral » sauf pour l’Allemagne pour qui il est : « geistig-religiösen und sittlichen », soit « spirituel-religieux ».
Pour le projet de Constitution, la présence de Dieu dans la Constitution fut un des sujets récurrents, le plus débattu. Finalement sur la base de la Déclaration annexée au Traité d’Amsterdam, un article 51 qui stipule : « Article 51 : Statut des églises et des organisations non confessionnelles. 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communauté religieuses dans les États membres. 2. L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces églises et organisations »2, a été adopté. Il sera repris in extenso dans l’article 17 du Traité de Lisbonne en 2009. Ce dialogue s’installe progressivement à partir de 2010.
Le dialogue article 17 avec la Commission européenne
En 2013, la Commission européenne publie un texte intitulé :« Lignes directrices de l’UE concernant la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction ». La première phrase de l’introduction rédigée ainsi : « Le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, plus communément désigné par l’expression « droit à la liberté de religion ou de conviction » place la question directement sous l’emprise idéologique anglo-saxonne et fait fi de l’esprit et de la lettre des textes communautaires eux-mêmes, notamment de l’article 10 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui précise : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion… ». Toute la différence résulte du remplacement d’un « et » par une virgule dans le texte des lignes directrices, mettant ainsi la liberté de religion au niveau de la liberté de pensée ou de conscience, alors que dans la Charte, conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la liberté de religion découle des libertés de pensée et de conscience. Cette pirouette sémantique permet par la suite à la Commission de ne traiter que de la liberté de religion, ainsi que le démontrent tous les paragraphes des Lignes directrices. Qu’on en juge par les titres des chapitres et paragraphes : « 1- Définitions, La liberté de religion ou de conviction est inscrite à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). ; Droit d’avoir une religion, d’avoir une conviction ou de ne pas croire ; Droit de manifester sa religion ou sa conviction. 2- Orientations opérationnelles ; A Principes fondamentaux ; 1. Caractère universel de la liberté de religion ou de conviction ; 2. La liberté de religion ou de conviction est un droit individuel qui peut être exercé en commun ; 3. Le rôle essentiel des États pour garantir la liberté de religion ou de conviction ; 4. Lien avec la défense d’autres droits de l’homme et avec d’autres orientations de l’UE relatives aux droits de l’homme » etc. Jamais il n’est question de liberté de pensée ou de conscience, mais apparaît uniquement la liberté de religion et de conviction. Ces Lignes directrices furent adoptées par le Conseil « Affaires étrangères », c’est à dire par les gouvernements des États membres, le 24 juin 2013.
Les initiatives de la Commission, mais aussi du Parlement dans le cadre de l’article 17 du TFUE, ne portent, toujours conformément à ces lignes directrices, que sur la liberté de religion et de conviction, et encore par obligation, mais pas sur la liberté de conscience ou de pensée.
Dialogue article 17 avec le Parlement
 Ci-contre, Antonella Sberna, vice-présidente du Parlement européen, actuelle chargée du dialogue au titre de l’article 17.
Ci-contre, Antonella Sberna, vice-présidente du Parlement européen, actuelle chargée du dialogue au titre de l’article 17.
En 2014, le Parlement européen crée « L’intergroupe du PE sur la liberté de religion et de croyance et la tolérance religieuse ». Cet intergroupe se présente lui-même sur son site uniquement en anglais : Traduction libre : « L’intergroupe sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse vise à garantir que l’UE, dans ses actions extérieures, promeut et protège le droit des individus à manifester librement leurs croyances (théistes, non théistes et athées). L’intergroupe sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse n’examine pas les mérites des différentes religions ou convictions, ou leur absence, mais veille à ce que le droit de croire ou de ne pas croire soit respecté. L’intergroupe sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse est impartial et ne s’aligne sur aucune religion ou conviction spécifique. » Dans le texte en anglais le terme utilisé est naturellement « Belief » qui crée forcément une ambiguïté, il ne concerne que les convictions religieuses et nous pouvons remarquer que les athées, agnostiques ou indifférents, qui pourtant dans plusieurs pays forment la majorité des populations, ne sont qu’entre parenthèses. Il n’est pas question de convictions non religieuses, ni de liberté de pensée ou de conscience dans cette présentation.
Il a fallu batailler plusieurs séances de rencontres « article 17 » pour obtenir une séance consacrée à la discrimination des athées dans le monde comme au sein de l’UE, qui démontra que la question n’était pas secondaire ; ce qui surprit beaucoup l’institution, mais resta sans lendemain. En mars 2019, en fin de mandat de législature, Madame Mairead Mac Guiness, Vice-présidente du Parlement européen, chargée du dialogue au titre de l’article 17, catholique irlandaise, publie un rapport proposant des accès privilégiés au Parlement pour les religieux. Suite aux protestations des organisations non confessionnelles et de députés européens, le Président du Parlement de l’époque, Antonio Tajani, donnera l’assurance qu’aucune mesure administrative ne serait prise en ce sens avant la législature suivante. Cette initiative sera effectivement sans suite officielle.
Depuis plusieurs législatures « une sainte messe catholique » est célébrée à l’ouverture des sessions du Parlement. En juin 2019, après les élections du Parlement européen, chaque élu a reçu une invitation l’informant qu’ « Une Sainte messe catholique sera célébrée mercredi 3 juillet 2019 dans la salle de méditation à 8h30. Elle aura lieu chaque mercredi des séances plénières à Strasbourg. Ces messes seront organisées avec l’archevêché de Strasbourg. Tous les collègues y sont cordialement invités ».
Le lobbying des églises et religions
Dés 1956, les catholiques sous l’impulsion des Jésuites s’organisent auprès des institutions européennes. L’Office catholique d’initiative pour l’Europe (OCIPE) est créé auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg. En 1980, la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) prend sa succession et élargit son champ à la Communauté économique. Elle est aujourd’hui le principal outil de lobbying de l’Église catholique auprès des instances européennes. En 1988, Jean-Paul II est invité à faire un discours au Parlement européen dans lequel il insiste sur « les fondements religieux et chrétiens de ce continent », en 1989 le Saint-Siège nomme un nonce apostolique pour les Communautés européennes, officialisant ainsi les relations entre le Vatican et l’UE. En 1994, Jacques Delors, Président de la Commission européenne lance l’initiative « Une âme pour l’Europe » et instaure ainsi les premiers contacts formels entre les institutions de l’UE et les religions. Par ailleurs, le courant catholique exerce une influence non négligeable auprès des instances de l’UE à travers ses réseaux associatifs caritatifs dans la société civile européenne.
Les « Églises » protestantes sont organisées sur des bases nationales. Il est donc plus difficile de générer un projet européen commun entre « Églises » organisées sur ces bases et dont, par ailleurs, la diversité, y compris au sein du même pays, est grande. Aussi, en raison des réticences de ces « Églises » à s’engager dans le processus de la construction européenne, la structuration spécifique sera à l’initiative « d’un groupe d’hommes politiques se réclamant du protestantisme et engagés dans la construction européenne » , qui crée en 1973 « l’Association œcuménique européenne pour Église et Société » (AOES). Puis, les questions sociales se faisant plus prégnantes (luttes contre la pauvreté, les « sans abri », égalité homme/femme, etc.), notamment après l’Acte unique, apparut un début de société civile européenne 86 . Les associations caritatives, le plus souvent d’origine religieuse, s’organisèrent au plan européen, soit en se regroupant pour avoir accès aux institutions, soit directement quand elles en avaient les moyens. Ainsi, l’organisation protestante allemande Diakonisches Werk (EKD) est très présente à Bruxelles. Par ailleurs, les Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes se sont réunies dans la « Conférence des Églises européennes » (CEC).
Les Églises orthodoxes comprennent plusieurs structures pour leur représentation, notamment l’Église autocéphale nationale de Grèce avec l’Église orthodoxe Russe (avant la guerre en Ukraine) et le Patriarche œcuménique de Constantinople.
La Conférence européenne des rabbins représente la religion juive. Elle est accompagnée de structures plus politiques visant à de meilleures relations entre l’Europe et l’État d’Israël, comme le Congrès juif européen ou, plus récent, la Fondation d’un bureau Loubavitch. Suite au Brexit, elle vient de quitter son siège historique de Londres pour s’installer à Munich, manifestant ainsi sa volonté de rester au sein de l’Union européenne.
L’organisation des musulmans est plus récente. L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a officialisé une mission permanente d’observation de l’Union européenne en juin 2013 et, plus récemment, le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE), établi en Belgique en novembre 2020, a pris la succession du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), auto-dissous la même année après avoir été dans le viseur du gouvernement français. Il a parmi ses projets « la constitution d’une équipe dévolue au dialogue auprès des institutions européennes ».
Toutes ces organisations pratiquent un lobbying auprès des institutions européennes et veulent peser sur les politiques communautaires, notamment sur les questions de lutte contre la pauvreté, les questions sociales et sociétales. Toutes participent aujourd’hui au « dialogue article 17 », notamment avec le Parlement européen.
Des organisations laïques de plusieurs pays européens ont créé la Fédération Humaniste Européenne en 1991. Depuis 2021, c’est le Réseau Laïque Européen qui intervient auprès des différentes instances de l’Union européenne.
Article de Jean-Claude Boual. Syndicaliste, militant laïque, secrétaire général adjoint de l’association Egale, acteur au sein des institutions européennes, Jean-Claude Boual est notamment l’auteur de « La laïcité en Europe. Un combat d’actualité pour une idée neuve » (Editions L’Harmattan, collection Débats laïques) »
Le Centre de recherche et d’information socio-politiques a publié en 2020 une étude « Le dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses et philosophiques ».
Mickaël Antoine est le rédacteur d’un Mémoire de recherche, sous la direction de Jean-Michel Ducomte, rendu en 2011, intitulé Mutation, organisation et influence des lobbies religieux et laïques à Bruxelles depuis l’élargissement de l’Union européenne et l’adoption du Traité de Lisbonne.
Pour être informé de la parution des nouveaux articles, il suffit de s’abonner en bas de la page d’accueil https://condorcet-europe.eu/