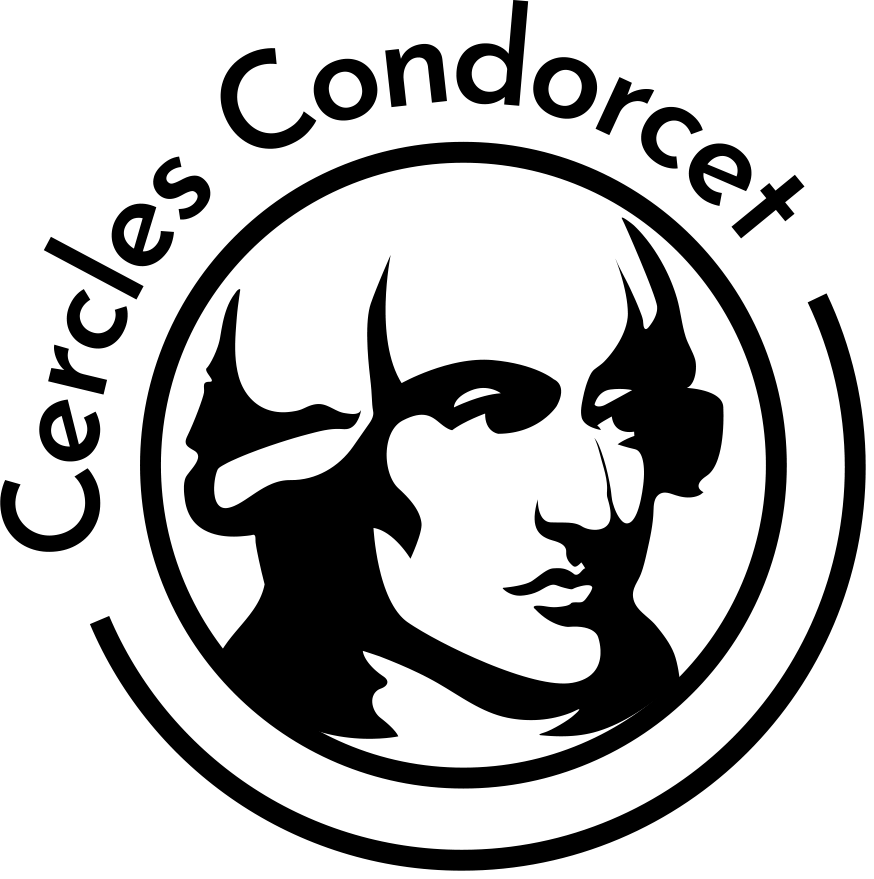Comment peut-on être Européen ?
Une défense européenne : le choix de la souveraineté
 Une étude de Jean-Michel Ducomte, enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, ancien avocat à la Cour d’appel de Toulouse, président de la Ligue de l’enseignement durant 14 ans, membre du Cercle Condorcet de Nantes.
Une étude de Jean-Michel Ducomte, enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, ancien avocat à la Cour d’appel de Toulouse, président de la Ligue de l’enseignement durant 14 ans, membre du Cercle Condorcet de Nantes.
Prise en étau entre deux logiques politiques attachées à la destruction ou à la vassalisation du modèle culturel dont elle a été et reste, pour l’essentiel, le creuset, l’Europe ou, plus exactement, la majorité des Etats qui la composent, se trouve une nouvelle fois confrontée à son infirmité militaire. Un autocrate manipulateur d’un côté, qui ne parvient à se consoler de la perte par l’Empire dont il a hérité depuis plus de vingt ans, des territoires que ce dernier avait soumis par la force ou l’influence. De l’autre, un voyou prédateur, sans morale, convaincu que seule la force et la contrainte peuvent lui permettre de satisfaire sa soif de puissance, d’argent et de reconnaissance…
Après avoir vécu l’orgueil des conquêtes coloniales, expérimenté la capacité des puissances souveraines qui la constituent à s’entre-détruire, lors de la guerre de trente ans puis lors des guerres napoléoniennes, son territoire fut l’un des champs de bataille principaux des deux conflits mondiaux du XXe siècle. L’Europe en sortit chaque fois plus affaiblie, insuffisamment consciente, que la victoire des valeurs de civilisation qu’elle considérait comme une composante centrale de son patrimoine idéologique, d’autres puissances la lui avaient offerte, moins pour ce qu’elle incarnait que pour les avantages que ces « sauveteurs » pensaient retirer de leur investissement.
La fragilité de l’Europe fut et reste, encore aujourd’hui, son morcellement. Espace d’invention de l’Etat-Nation, mais aussi traversée de tentatives plus ou moins longues d’unions forcées, d’unifications culturelles ou de rêves d’unité, elle n’est
jamais parvenue à se transformer en puissance. La brutalité du deuxième conflit mondial caractérisé par une tentative de remise en cause des fondements même de la civilisation européenne, et qui s’était terminé avec l’émergence d’un nouvel
adversaire, l’URSS alliée la veille dans la lutte contre le nazisme ainsi que les diverses émergences fascistes, a déterminé la mise en œuvre d’une nouvelle tentative de dépassement des antagonismes d’hier.
 Rien n’interdit à un certain nombre d’États de l’Union Européenne de décider de constituer entre eux une entité fédérale souveraine à laquelle seront dévolus les compétences relatives aux affaires étrangères et à leur défense (définition des
Rien n’interdit à un certain nombre d’États de l’Union Européenne de décider de constituer entre eux une entité fédérale souveraine à laquelle seront dévolus les compétences relatives aux affaires étrangères et à leur défense (définition des
alliances, des stratégies, des politiques d’armement, etc.) sans qu’une telle décision affecte leur participation à l’Union Européenne. L’entité ainsi créée hériterait en quelque sorte des droits dont ils disposent en qualité de membres de l’Union. L’équilibre de l’ensemble en serait nécessairement modifié, des adaptations se révèleraient nécessaires, notamment en ce qui concerne les modalités de la représentation dans les instances de décision de l’Union, mais la substance des politiques conduites par l’Union n’en serait en rien bouleversée. Les seuls aménagements d’importance à réaliser relevant de décisions prises au sein de la nouvelle entité ainsi créée…
A l’évidence, le noyau dur en serait constitué par cinq des six États fondateurs de la Communauté autour du couple franco-allemand auxquels pourraient s’adjoindre l’Espagne et le Portugal de même que la Pologne, le Danemark, la Suède, la Finlande et les États Baltes. L’essentiel est question de volonté. En acceptant de travailler la question de la souveraineté et de la puissance, l’Europe se mettra en situation de résoudre celle, jamais clairement posée de son identité, c’est-à-dire de son ambition.
Texte intégral Ducomte. Une défense européenne le choix de la souveraineté
Illustration Athéna et Diomède. Sculpture de Albert Wolff. 1853.