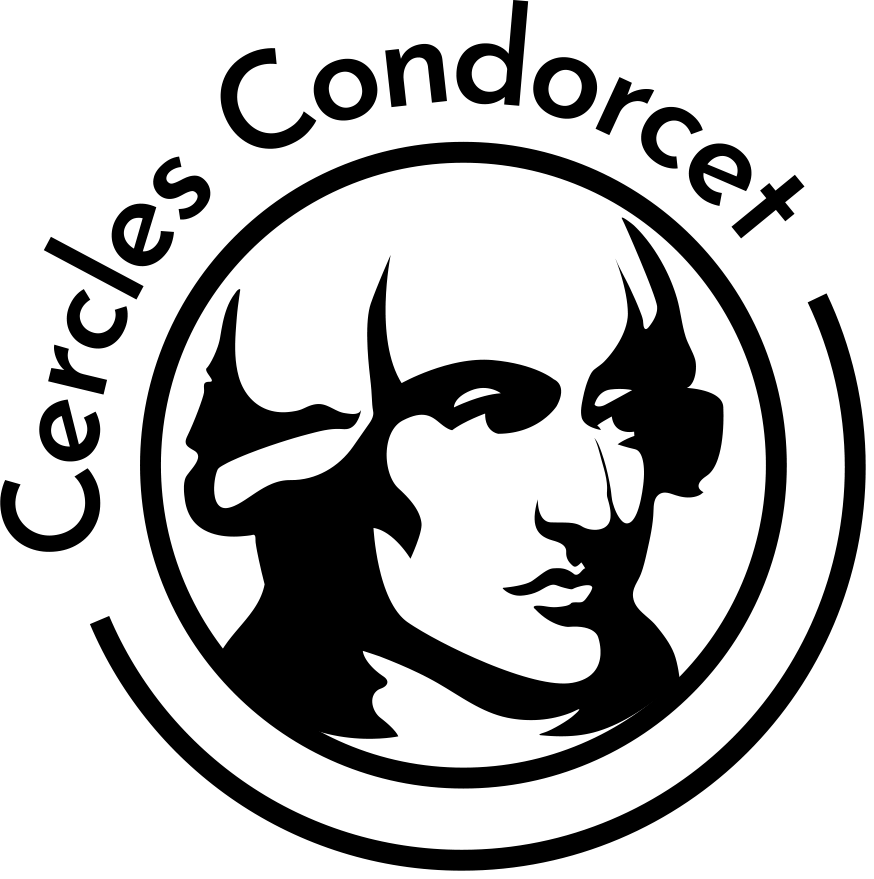Comment peut-on être Européen ?
L’Union européenne et la question environnementale: à la croisée des chemins.
Au fil des dernières décennies, on a vu simultanément l’émergence de cet objet politique sans équivalent qu’est l’Union Européenne et celle de la question environnementale ; guère étonnant donc que cette thématique tienne une place significative dans les politiques communautaires. Mais leur application et leur approfondissement sont désormais mis à l’épreuve des faits et confrontés à une actualité géopolitique chaotique.
Un article de Marc Chatelain, membre du Cercle Condorcet de Bourg-en-Bresse, président de la Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain.
Genèse d’une politique environnementale communautaire
 Dans le contexte des « Trente Glorieuses » qui fut celui des premières étapes de la construction européenne, la question environnementale ne pesait pas grand-chose : il s’agissait avant tout de s’extraire de la misère d’un continent détruit. L’édification précoce de la Politique Agricole Commune (PAC) est un bon exemple à cet égard.
Dans le contexte des « Trente Glorieuses » qui fut celui des premières étapes de la construction européenne, la question environnementale ne pesait pas grand-chose : il s’agissait avant tout de s’extraire de la misère d’un continent détruit. L’édification précoce de la Politique Agricole Commune (PAC) est un bon exemple à cet égard.
Pour la bien nommée Communauté Economique Européenne, les prémices d’une prise de conscience sont néanmoins perceptibles dès les années 70 avec l’ébauche d’un plan d’action environnemental, et surtout l’adoption en 1979 d’une directive fondatrice dédiée à la conservation des oiseaux sauvages, qui fait figure de cas d’école : la Communauté ne disposant alors d’aucune compétence en la matière, elle se fonda juridiquement sur une « clause de flexibilité1 » du traité de Rome, et techniquement sur la dimension intrinsèquement transfrontalière de la biologie et de la protection des oiseaux sauvages, bien souvent migrateurs. Les sources d’inspiration vinrent des Etats-Unis, alors promoteurs d’une législation novatrice en faveur de la biodiversité (« Endangered Species Act » de 1973, dont les principes sont désormais fortement ébranlés par les coups de boutoir trumpistes) et sur notre continent de sociétés savantes telles que la Royal Society for the Protection of Birds (les Britanniques s’étant révélés d’éminents contributeurs, quoique turbulents, à la construction des politiques européennes).
Ensuite et au-delà de ce texte précurseur, le champ d’intervention communautaire se consolidera, s’étendra considérablement et se dotera de puissants outils de mise en œuvre, notamment législatifs et financiers.
Sa consolidation s’opérera sur le socle des traités fondateurs : Acte unique européen de 1986, (intégrant un titre dédié à l’environnement au Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne), principe de prise en compte dans toutes les politiques, Traité de Maastricht de 1992 (insérant l’environnement dans les objectifs de la Communauté sous le régime de la codécision), Traité d’Amsterdam de 1997 (faisant du « développement durable » un des objectifs de l’Union)… On verra ainsi l’émergence d’un « droit dérivé » fondé sur ces traités, doté d’un arsenal de règlements (directement applicables par les Etats membres) et de directives (fixant des obligations de résultat et nécessitant une transposition dans chaque législation nationale) ; parmi les codes législatifs français, celui de l’environnement apparaît ainsi parmi les plus imprégnés de droit communautaire.
Son extension portera sur des thématiques très diverses : lutte contre la pollution, protection de la biodiversité et de la ressource en eau, prévention des risques industriels, gestion des déchets, évaluation environnementale des projets d’aménagement, et plus récemment prise en compte du changement climatique et émergence d’une économie décarbonée.
Au travers du droit dérivé et de programmes d’actions spécifiques sa mise en œuvre passera par la définition d’objectifs communs souvent très (trop?) ambitieux ; ainsi : la « directive-cadre sur l’eau » de 2000 fixait un objectif de bonne qualité des eaux de surface et souterraines dès 2015 (échéance reportée à 2027 sous certaines conditions) ; le Pacte vert pour l’Europe (« Green Deal, 2019 ») affiche un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et de neutralité carbone à horizon 2050. Elle s’appuiera sur des financements dédiés, tels que L’Instrument Financier pour l’Environnement (fonds LIFE) : depuis 32 ans, celui-ci a cofinancé plus de 6 000 projets (lutte contre la pollution, protection de la biodiversité, neutralité carbone…) au sein de l’UE mais aussi de pays associés (Islande, Moldavie, Ukraine…). Outre les retombées perceptibles au travers d’actions concrètes, le bilan de ce programme s’avère très positif en termes de partage d’expertise, de diffusion de bonnes pratiques à l’échelle européenne et d’information du grand public.
A l’épreuve des faits
Mais ce bel édifice, qui se pose volontiers en modèle planétaire (Natura 2000 se veut ainsi le plus grand réseau d’aires protégées terrestres et marines au monde), se heurte néanmoins à la nécessité d’arbitrages multiples et parfois douloureux au regard d’autres objectifs communautaires : la conciliation des politiques environnementales avec les objectifs productivistes de la PAC vire ainsi périodiquement au psychodrame, quand bien même l’érosion continue et bien documentée de la biodiversité des milieux agricoles vient cruellement rappeler combien les résultats demeurent décevants.
 La conciliation des enjeux peut s’avérer illusoire lorsqu’il s’agit de prendre en compte protection de la nature, développement des infrastructures, menace russe et crise migratoire. Tournons-nous donc vers la région polonaise limitrophe de l’enclave russe de Kaliningrad, de la Lituanie et de la Biélorussie. Avec ses immenses marais de la Biebrza et de la Rospuda, et les vastes forêts réputées « primaires » de Białowieża et d’Augustów refuges du Bison d’Europe, elle compte parmi les paysages naturels les plus suggestifs d’Europe du nord ; le droit européen est censé les protéger à ce titre au travers du réseau « Natura 2000 ». Avec l’étroit corridor de Suwałki, elle commande aussi l’unique et fragile continuité terrestre de l’UE vers les pays baltes (65 km de large) et point de passage obligé des infrastructures routières et ferroviaires nouvelles de la « Via baltica », promus à grands coups de fonds structurels européens… et génératrices d’impacts environnementaux majeurs. Qui plus est, le dit corridor s’avère désormais la hantise de l’OTAN, qui y déploie ses antennes-radar, ses exercices militaires et ses survols permanents d’hélicoptères face à la menace russe. Enfin, avec sa longue frontière biélorusse tracée en pleine forêt, elle est le théâtre d’une sinistre traque aux migrants, et voit l’érection d’un nouveau mur de la honte, hermétique aux réfugiés tout autant qu’à la faune sauvage…
La conciliation des enjeux peut s’avérer illusoire lorsqu’il s’agit de prendre en compte protection de la nature, développement des infrastructures, menace russe et crise migratoire. Tournons-nous donc vers la région polonaise limitrophe de l’enclave russe de Kaliningrad, de la Lituanie et de la Biélorussie. Avec ses immenses marais de la Biebrza et de la Rospuda, et les vastes forêts réputées « primaires » de Białowieża et d’Augustów refuges du Bison d’Europe, elle compte parmi les paysages naturels les plus suggestifs d’Europe du nord ; le droit européen est censé les protéger à ce titre au travers du réseau « Natura 2000 ». Avec l’étroit corridor de Suwałki, elle commande aussi l’unique et fragile continuité terrestre de l’UE vers les pays baltes (65 km de large) et point de passage obligé des infrastructures routières et ferroviaires nouvelles de la « Via baltica », promus à grands coups de fonds structurels européens… et génératrices d’impacts environnementaux majeurs. Qui plus est, le dit corridor s’avère désormais la hantise de l’OTAN, qui y déploie ses antennes-radar, ses exercices militaires et ses survols permanents d’hélicoptères face à la menace russe. Enfin, avec sa longue frontière biélorusse tracée en pleine forêt, elle est le théâtre d’une sinistre traque aux migrants, et voit l’érection d’un nouveau mur de la honte, hermétique aux réfugiés tout autant qu’à la faune sauvage…

Tracé du nouveau mur érigé à la frontière extérieure de l’UE, passant au beau milieu de la forêt primaire de Białowieża
Vers une régression généralisée ?
Désormais, l’UE est en outre violemment percutée par le puissant mouvement de reflux à l’œuvre au niveau mondial en matière de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, qui combine montée en puissance de partis réactionnaires hostiles à ces thématiques, défiance massive envers le discours scientifique, désinformation dopée par les réseaux sociaux, affaiblissement des organisations internationales et promotion tout azimut d’une dérégulation décomplexée.
Face au désengagement des grands Etats (au premier rang desquels les USA), elle tend à passer pour un acteur désuet et normatif perclus de technocratisme, et peut être tentée elle aussi de renier ses engagements. L’actualité récente montre que les régressions s’opèrent désormais à tous niveaux : local (avec le retrait des financements alloués à certaines associations de protection de la nature jugées trop « militantes »), national (avec la remise en cause d’institutions dédiées à la protection de l’environnement ou la promulgation de la Loi Duplomb dans des conditions acrobatiques), et désormais européen.
 Ainsi, la nouvelle « feuille de route » de la Commission Européenne a déjà considérablement réduit les ambitions du « Pacte vert », et la proposition de budget de l’Union pour la période 2028-2034 semble vouloir tirer un trait sur le programme LIFE précité. Un tel choix ferait fi d’un bilan plus que convaincant, et rendu tangible au travers de nombreuses réalisations locales à même de valoriser les apports positifs de l’UE , y compris aux yeux du grand public : mise en œuvre d’un nouveau process de traitement des eaux polluées, restauration d’une zone humide, programme de réintroduction d’espèce menacée, projet de lutte contre la désertification, filière innovante de recyclage des déchets d’emballage…
Ainsi, la nouvelle « feuille de route » de la Commission Européenne a déjà considérablement réduit les ambitions du « Pacte vert », et la proposition de budget de l’Union pour la période 2028-2034 semble vouloir tirer un trait sur le programme LIFE précité. Un tel choix ferait fi d’un bilan plus que convaincant, et rendu tangible au travers de nombreuses réalisations locales à même de valoriser les apports positifs de l’UE , y compris aux yeux du grand public : mise en œuvre d’un nouveau process de traitement des eaux polluées, restauration d’une zone humide, programme de réintroduction d’espèce menacée, projet de lutte contre la désertification, filière innovante de recyclage des déchets d’emballage…
De telles orientations ne manqueraient pas de convertir massivement les défenseurs de l’environnement, en général plutôt convaincus jusqu’à présent des bénéfices de la construction européenne, au scepticisme ambiant à son encontre.
Osons encore espérer qu’elles ne seront pas retenues, alors que chaque jour nous convint un peu plus de l’urgence de la question environnementale…
Illustrations
Tableau de Hans Dahl (1849 – 1937), peintre norvégien, membre de l’École de peinture de Düsseldorf. Ce peintre reste très populaire dans les pays scandinaves où la sensibilité à la question environnementale est vive. Il illustre dans son œuvre tout entière consacrée à la nature la sensibilité romantique qui perdure sous de nouvelles formes aujourd’hui.
Vallée de la Biebrza, Photo Marc Chatelain. Cette zone humide remarquable, intégrée au réseau européen Natura 2000, est directement menacée par les nouveaux projets d’infrastructures de transport et perturbée par les exercices militaires au long de la frontière extérieure de l’UE.
Carte. Tracé du nouveau mur érigé à la frontière extérieure de l’UE, passant au beau milieu de la forêt primaire de Białowieża DR Marc Chatelain.
Green deal in danger. Affiche de la pétition lancée par The Global Network for Human Rights and the Environment
Pour être informé de la parution des nouveaux articles, il suffit de s’abonner en bas de la page d’accueil https://condorcet-europe.eu/