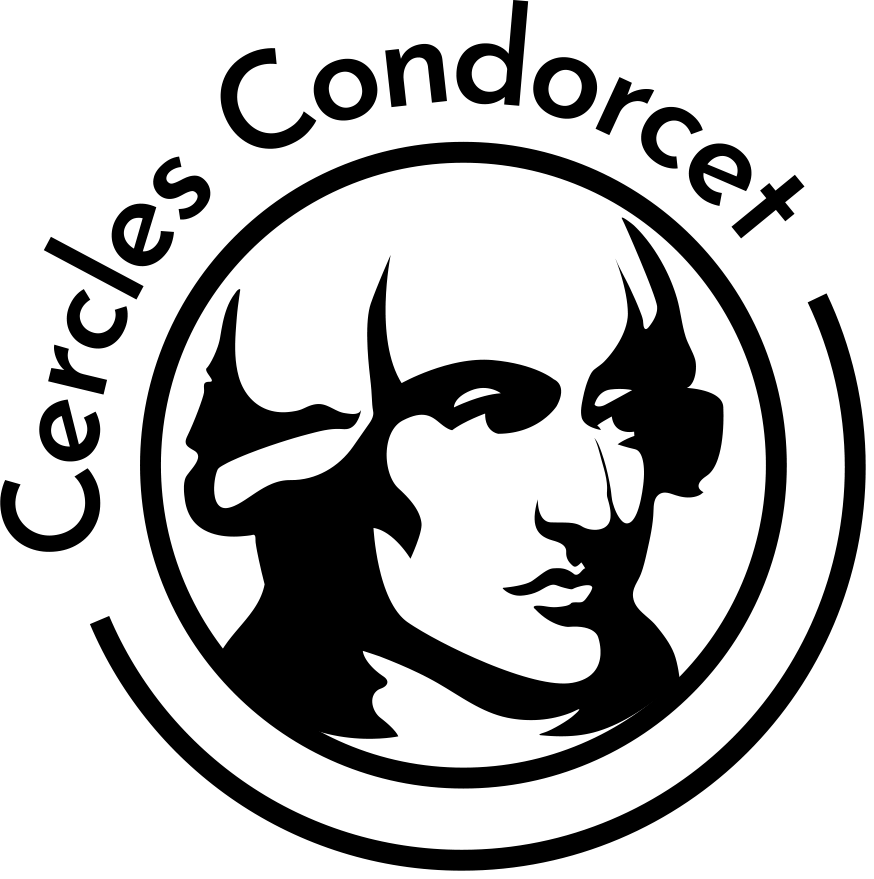Comment peut-on être Européen ?
Le monde méconnu des ouvriers européens
Les ouvriers ont quasiment disparu des scènes politique et artistique. Les ouvriers et les employés constituent en France la moitié de la population active, et donc du corps électoral. Depuis 2017, aucun parlementaire n’est ouvrier. Moins de 5 % sont employés. Seuls quelques cinéastes et écrivains mettent en valeur les mondes ouvrier et populaire. 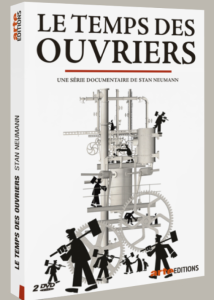 En 2020 le réalisateur Stan Neumann propose une histoire du monde ouvrier sur les trois derniers siècles « Le temps des ouvriers« . Ce documentaire en quatre épisodes est accompagné d’un commentaire dit par Bernard Lavilliers. Il pose une question déterminante : « Quelle est la place des ouvriers dans le monde qu’ils ont largement contribué à créer ? ». Les ouvrières et les ouvriers constituent 20 % de la population. Elles et ils peuplent nos arbres généalogiques. Quelle est leur place dans notre mémoire collective ? Quelle est leur place dans l’avenir que nous voulons construire ? Toute transformation sociale est inimaginable sans elles et eux. On se plongera avec passion dans ce documentaire de quatre heures. Il décrit avec rigueur mais sans misérabilisme cette histoire ouvrière. Des moments sont marquants. Le début de cette histoire en Angleterre, avec l’appropriation des terres communales par les puissants, la création des filatures, le « factory system ». Le tisserand qui achetait le coton, travaillait chez lui, et revendait le tissu est contraint de se soumettre aux conditions draconiennes des centaines de filatures qui se créent alors. Jacques Rancière souligne que, au-delà de la pénibilité, « ce qui est central pour définir l’être ouvrier et du même coup la souffrance ouvrière, c’est l’absence de temps ». C’est cette analyse qui donne son nom à la série documentaire. Nombre d’autres historiens sont sollicités : l’italien Alessandro Portelli, l’allemand Stefan Berger, l’anglais Arthur McIvor, la française Marion Fontaine…
En 2020 le réalisateur Stan Neumann propose une histoire du monde ouvrier sur les trois derniers siècles « Le temps des ouvriers« . Ce documentaire en quatre épisodes est accompagné d’un commentaire dit par Bernard Lavilliers. Il pose une question déterminante : « Quelle est la place des ouvriers dans le monde qu’ils ont largement contribué à créer ? ». Les ouvrières et les ouvriers constituent 20 % de la population. Elles et ils peuplent nos arbres généalogiques. Quelle est leur place dans notre mémoire collective ? Quelle est leur place dans l’avenir que nous voulons construire ? Toute transformation sociale est inimaginable sans elles et eux. On se plongera avec passion dans ce documentaire de quatre heures. Il décrit avec rigueur mais sans misérabilisme cette histoire ouvrière. Des moments sont marquants. Le début de cette histoire en Angleterre, avec l’appropriation des terres communales par les puissants, la création des filatures, le « factory system ». Le tisserand qui achetait le coton, travaillait chez lui, et revendait le tissu est contraint de se soumettre aux conditions draconiennes des centaines de filatures qui se créent alors. Jacques Rancière souligne que, au-delà de la pénibilité, « ce qui est central pour définir l’être ouvrier et du même coup la souffrance ouvrière, c’est l’absence de temps ». C’est cette analyse qui donne son nom à la série documentaire. Nombre d’autres historiens sont sollicités : l’italien Alessandro Portelli, l’allemand Stefan Berger, l’anglais Arthur McIvor, la française Marion Fontaine…  C’est toute l’Europe qui est revisitée au prisme de cette histoire : le coton à Manchester, les automobiles Peugeot à Sochaux, Fiat à Turin, la sidérurgie à Seraing… En recourant notamment à des extraits de films. « Les Tisserands » (Die Weber), film allemand sorti en 1927 décrivant une grève des tisserands silésiens. « La Symphonie du Donbass », film documentaire soviétique sorti en 1930, sur une région industrielle qui fait aujourd’hui l’objet d’une tragique actualité. La vie quotidienne fait l’objet de nombreux témoignages. La souffrance, mais aussi la fierté. Une certaine affirmation virile et fraternelle dans l’accomplissement du travail et dans les combats. On a pu parler, comme Victor Hugo devant les immenses usines de Manchester, d’un « sublime ouvrier » mêlant terreur grandiose et beauté de l’action humaine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses. Et elles s’affirment aussi. La grève de 1400 allumetières à Londres au début du XIX° siècle est exemplaire. Elle a pour but de pouvoir s’adresser à la direction sans passer par les contremaitres hommes. La revendication portée est que la cantine soit séparée des ateliers pour que la nourriture ne soit pas contaminée par le phosphore. Le travail des enfants est notamment illustré par les émouvantes et célèbres photos de Lewis W. Hine.
C’est toute l’Europe qui est revisitée au prisme de cette histoire : le coton à Manchester, les automobiles Peugeot à Sochaux, Fiat à Turin, la sidérurgie à Seraing… En recourant notamment à des extraits de films. « Les Tisserands » (Die Weber), film allemand sorti en 1927 décrivant une grève des tisserands silésiens. « La Symphonie du Donbass », film documentaire soviétique sorti en 1930, sur une région industrielle qui fait aujourd’hui l’objet d’une tragique actualité. La vie quotidienne fait l’objet de nombreux témoignages. La souffrance, mais aussi la fierté. Une certaine affirmation virile et fraternelle dans l’accomplissement du travail et dans les combats. On a pu parler, comme Victor Hugo devant les immenses usines de Manchester, d’un « sublime ouvrier » mêlant terreur grandiose et beauté de l’action humaine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses. Et elles s’affirment aussi. La grève de 1400 allumetières à Londres au début du XIX° siècle est exemplaire. Elle a pour but de pouvoir s’adresser à la direction sans passer par les contremaitres hommes. La revendication portée est que la cantine soit séparée des ateliers pour que la nourriture ne soit pas contaminée par le phosphore. Le travail des enfants est notamment illustré par les émouvantes et célèbres photos de Lewis W. Hine.  Les combats syndicaux et politiques sont évoqués avec des images fortes. Les répressions sanglantes comme à Fourmies le 1er mai 1891. La Fête des Travailleurs, symbolisée par une églantine écarlate, fleur traditionnelle du Nord, en souvenir du sang versé à Fourmies, est devenu le moment emblématique de cette affirmation de soi devenue identité culturelle. D’où découlaient la conscience politique et la puissance mobilisatrice. Avec de grandes victoires telles que celle du Front populaire en France. Après 1945 le stalinisme veut mettre les mouvements ouvriers à la botte. A l’Ouest le néolibéralisme fait des ravages, notamment en abandonnant les vieux pays industriels pour d’autres contrées où la misère rend la main d’œuvre plus docile. Ce sont les défaites de Solidarność, fédération de syndicats polonais dans les années 1980, et de l’Union Nationale des Mineurs anglaise en 1984 mobilisée contre la fermeture vingt puits de mines de charbon. Les questions posées par Pierre-Joseph Proudhon dans « De la capacité politique des classes ouvrières » restent d’actualité. « La question des candidatures ouvrières implique celle de la capacité politique des ouvriers, ou pour me servir d’une expression plus générique, du Peuple. Le Peuple, à qui la Révolution de 1848 a accordé la faculté de voter, est-il, oui ou non, capable d’ester en politique ? ». Questions reprises plus tard par Antonio Gramsci prônant un «bloc historique » entre la classe ouvrière et la classe moyenne en voie de précarisation…
Les combats syndicaux et politiques sont évoqués avec des images fortes. Les répressions sanglantes comme à Fourmies le 1er mai 1891. La Fête des Travailleurs, symbolisée par une églantine écarlate, fleur traditionnelle du Nord, en souvenir du sang versé à Fourmies, est devenu le moment emblématique de cette affirmation de soi devenue identité culturelle. D’où découlaient la conscience politique et la puissance mobilisatrice. Avec de grandes victoires telles que celle du Front populaire en France. Après 1945 le stalinisme veut mettre les mouvements ouvriers à la botte. A l’Ouest le néolibéralisme fait des ravages, notamment en abandonnant les vieux pays industriels pour d’autres contrées où la misère rend la main d’œuvre plus docile. Ce sont les défaites de Solidarność, fédération de syndicats polonais dans les années 1980, et de l’Union Nationale des Mineurs anglaise en 1984 mobilisée contre la fermeture vingt puits de mines de charbon. Les questions posées par Pierre-Joseph Proudhon dans « De la capacité politique des classes ouvrières » restent d’actualité. « La question des candidatures ouvrières implique celle de la capacité politique des ouvriers, ou pour me servir d’une expression plus générique, du Peuple. Le Peuple, à qui la Révolution de 1848 a accordé la faculté de voter, est-il, oui ou non, capable d’ester en politique ? ». Questions reprises plus tard par Antonio Gramsci prônant un «bloc historique » entre la classe ouvrière et la classe moyenne en voie de précarisation…