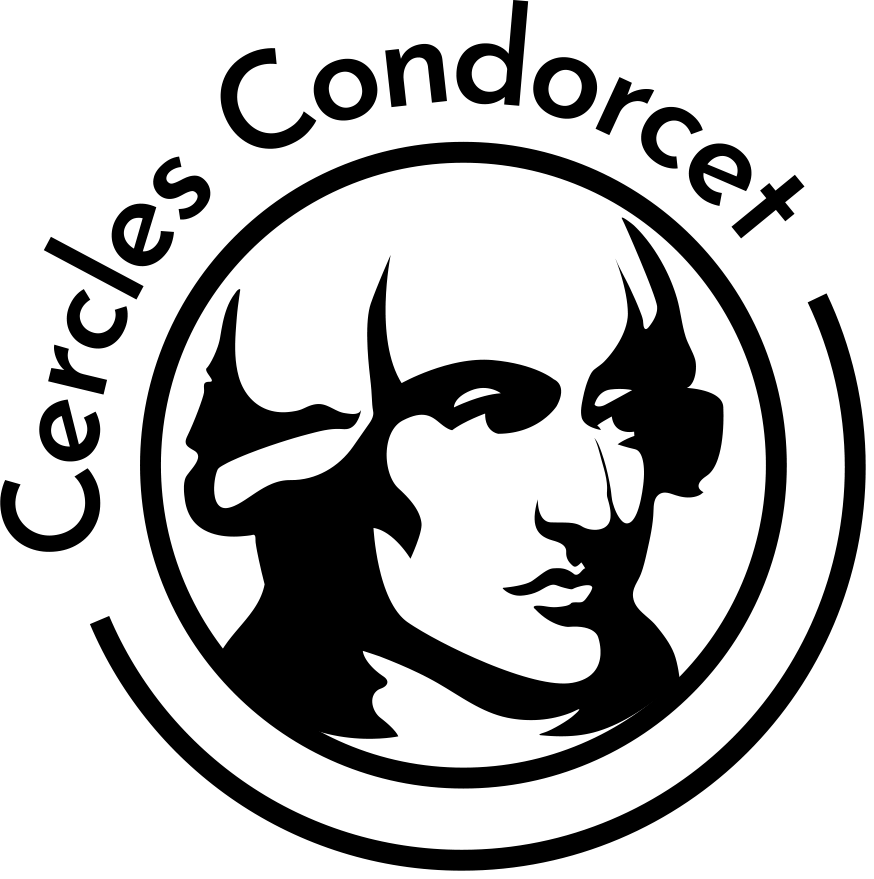Comment peut-on être Européen ?
La campagne de France d’un exilé russe
Comprendre l’Europe, c’est aussi explorer son histoire. Au travers notamment d’aventures singulières dans un continent parfois saisi par une démesure suicidaire. Une recension de Philippe Brenot, journaliste.
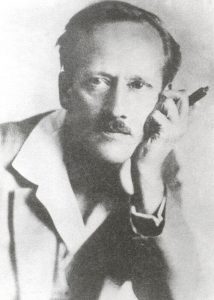 « Dans une bourgade paisible de France » (Verdier) est la chronique de l’exode et de la seconde moitié de l’année 1940 par Mikhaïl Ossorguine, écrivain russe exilé à Paris puis à Chabris (Indre) pour échapper aux Nazis. Son humanisme résonne avec l’actualité d’aujourd’hui. Pourquoi, à 85 ans de distance, ce récit nous touche-t-il autant ? Pourquoi sommes-nous ainsi tenus par cette chronique de la vie d’une « bourgade » du cœur rural d’un pays qui, sonné par la débâche de juin 1940 et l’armistice, entre doucement dans la « collaboration », au lendemain de la poignée de main de Montoire entre Hitler et Pétain ? Surtout lorsque ces « choses vues » sont signées d’un auteur inconnu de nous.
« Dans une bourgade paisible de France » (Verdier) est la chronique de l’exode et de la seconde moitié de l’année 1940 par Mikhaïl Ossorguine, écrivain russe exilé à Paris puis à Chabris (Indre) pour échapper aux Nazis. Son humanisme résonne avec l’actualité d’aujourd’hui. Pourquoi, à 85 ans de distance, ce récit nous touche-t-il autant ? Pourquoi sommes-nous ainsi tenus par cette chronique de la vie d’une « bourgade » du cœur rural d’un pays qui, sonné par la débâche de juin 1940 et l’armistice, entre doucement dans la « collaboration », au lendemain de la poignée de main de Montoire entre Hitler et Pétain ? Surtout lorsque ces « choses vues » sont signées d’un auteur inconnu de nous.
Sans être un révolutionnaire dans l’âme, Mikhaïl Ossorguine, né en 1878 à Perm, dans l’Oural, aura passé la moitié de sa vie à l’étranger, emprisonné et exilé pour ses écrits par le régime tsariste après la révolution de 1905, puis par son alter égo soviétique. En 1922 le voilà donc à Paris, où il occupe bientôt une place de choix dans le milieu intellectuel russe émigré par l’intérêt rencontré par ses essais et romans, dont Une rue à Moscou, tout récemment réédité, est le plus fameux.
En mai-juin 1940, dans l’affolement général, comme tant d’autres Ossorguine et sa femme se retrouvent sur les routes et, suivant des amis russes qui y ont loué une maison, échouent à Chabris, dans l’Indre. Après quelques semaines d’incertitude, le couple revient à Paris pour découvrir des scellés posés sur la porte de leur appartement du 6e arrondissement. La riche bibliothèque, elle, a été vidée. Éminent franc-maçon, Ossorguine figure sur la liste noire des Nazis. Impossible donc de se réfugier dans leur villégiature de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Voilà donc le couple de retour à Chabris, après avoir usé de la ruse et bénéficié d’une certaine bonhomie de la sentinelle allemande pour franchir le pont sur le Cher, dont le cours épouse désormais la ligne de démarcation qui sépare la zone occupée de la zone libre. En cela, Chabris se va se révéler un excellent poste d’observation, aux premières loges pour recueillir les rumeurs colportées par celles et ceux qui sont autorisés à passer quotidiennement de l’autre côté, en particulier une certaine Mme Jeannette, largement citée.
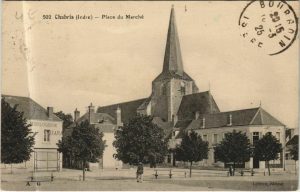 Comme l’explique le chercheur Leonid Livak dans sa présentation de l’auteur et de l’ouvrage, ce récit n’a pas été pensé comme tel à l’origine mais composé à partir des lettres postées par Mikhaïl Ossorguine aux États-Unis et publiées outre-Atlantique dans La Nouvelle Parole russe. Et si l’auteur ne peut s’empêcher d’y glisser des réflexions sur l’effondrement de la tradition humaniste et culturelle européenne incarnée par son pays d’exil, son texte se nourrit avant tout d’observations et d’anecdotes rehaussées de traits d’humour et d’ironie. Mikhaïl Ossorguine explique par ailleurs que, dans le contexte du moment, le recours à l’imaginaire lui apparaît hors de propos. Aussi entend-il proposer une relation strictement documentaire.
Comme l’explique le chercheur Leonid Livak dans sa présentation de l’auteur et de l’ouvrage, ce récit n’a pas été pensé comme tel à l’origine mais composé à partir des lettres postées par Mikhaïl Ossorguine aux États-Unis et publiées outre-Atlantique dans La Nouvelle Parole russe. Et si l’auteur ne peut s’empêcher d’y glisser des réflexions sur l’effondrement de la tradition humaniste et culturelle européenne incarnée par son pays d’exil, son texte se nourrit avant tout d’observations et d’anecdotes rehaussées de traits d’humour et d’ironie. Mikhaïl Ossorguine explique par ailleurs que, dans le contexte du moment, le recours à l’imaginaire lui apparaît hors de propos. Aussi entend-il proposer une relation strictement documentaire.
L’intellectuel citadin et cosmopolite se tient pour cela au plus près des habitants, qui en cette seconde moitié de l’année 1940 se montrent attentistes, et dont l’inertie ou la réserve face aux mesures édictées par Vichy et les autorités allemandes ressemblent à une sourde résistance. Et si par la force des choses il est beaucoup question de tickets de rationnement, c’est aussi l’impossibilité d’écouler les fruits d’une terre féconde qui travaille l’âme paysanne du bourg. Ou bien encore l’interdiction – finalement temporaire – de pêcher sur les bords du Cher au risque de se faire tirer dessus, afin de ne pas favoriser la traversée clandestine du fleuve par les soldats évadés et autres proscrits. Pour sa part, Ossorguine est particulièrement touché par les mesures anti-juives de l’automne. Désormais coupés avec son épouse de toutes leurs connaissances, isolés dans la vénérable maison qu’ils ont pu trouver à louer, il l’est aussi par la bienveillance des gens à leur égard.
On pourra penser aux récits de son exact contemporain que fut Léon Werth : 33 jours, sur l’exode, et surtout à Déposition, journal des années 1940-44 tenu un petit village du Jura. Dans une bourgade paisible de France n’en a ni l’ampleur ni le ton, ici plus impressionniste et parfaitement accordé à son titre. On pourra penser aussi à tous les exilés et déplacés qui, de l’Ukraine au Moyen-Orient, vivent dans l’incertitude du lendemain. Celle avec laquelle se clôt, au dernier jour de l’année 1940, le récit de Mikhaïl Ossorguine. Lequel décèdera en 1942, à Chabris, où il est enterré.
INDEX GENERAL DU SITE « COMMENT PEUT-ON ETRE EUROPEEN ? »
Pour être informé de la parution des nouveaux articles, il suffit de s’abonner en bas de la page d’accueil https://condorcet-europe.eu/