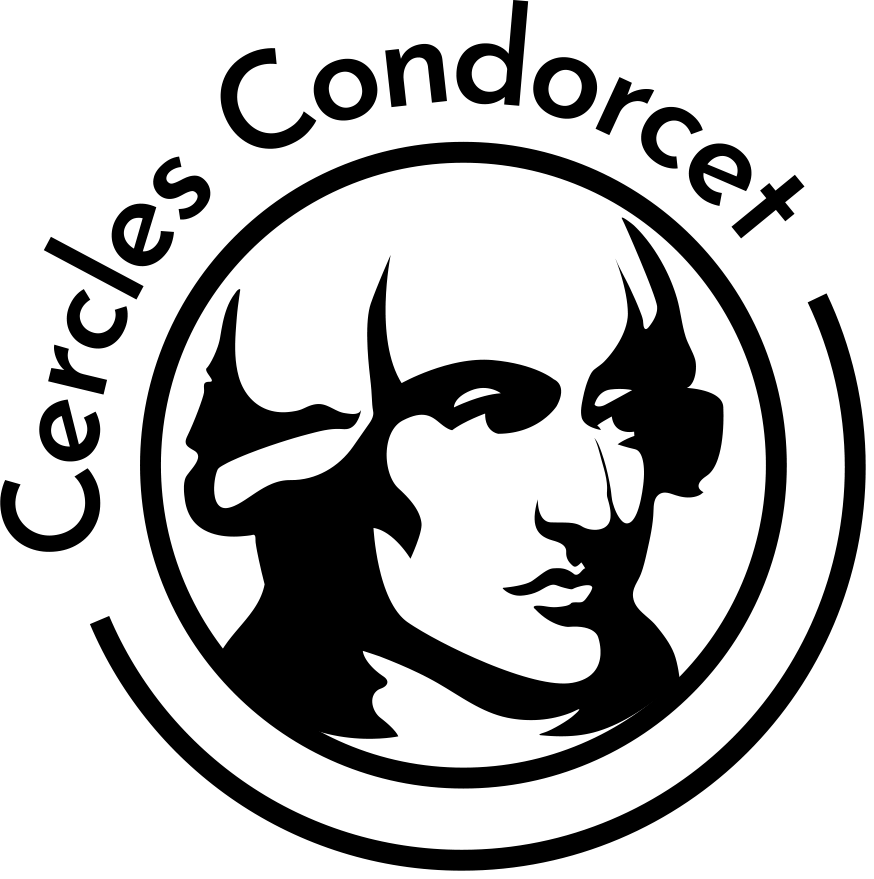Comment peut-on être Européen ?
Existe-t-il un patrimoine européen ?
Une étude de Jacques Limouzin, co-auteur de « Une histoire européenne de l’Europe » (Privat) et directeur de « Regards sur le patrimoine » (SCEREN).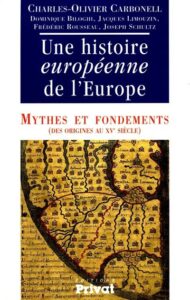 Je sais d’expérience que s’exprimer sur l’Europe est, non pas dangereux, mais susceptible d’engendrer la suspicion. D’un côté du champ de bataille où s’affrontent les idéologies et les postures, des gardiens nationalistes suspectent que l’on cherche à tuer les nations qu’ils chérissent pieusement. De l’autre, des vigiles décoloniaux soupçonnent illico la valorisation d’une civilisation contre les autres, celles des victimes éternelles qu’ils ont charitablement prises en protection.
Je sais d’expérience que s’exprimer sur l’Europe est, non pas dangereux, mais susceptible d’engendrer la suspicion. D’un côté du champ de bataille où s’affrontent les idéologies et les postures, des gardiens nationalistes suspectent que l’on cherche à tuer les nations qu’ils chérissent pieusement. De l’autre, des vigiles décoloniaux soupçonnent illico la valorisation d’une civilisation contre les autres, celles des victimes éternelles qu’ils ont charitablement prises en protection.
J’ai vécu cela à l’occasion de l’écriture d’un livre collectif intitulé « Une histoire européenne de l’Europe » et dirigé par le regretté Charles-Olivier Carbonell (Privat, 1999). L’universitaire ne se proposait pas de nier ou minorer les différences et les conflits qui ont séparé dans l’histoire et séparent toujours les multiples territoires du continent et ses indéniables particularités. Il voulait trier ce qu’ils avaient en commun et il m’avait confiée la partie d’histoire médiévale de l’ouvrage. Les tirs croisés des suspicieux, semble-t-il peu familiers de la notion d’échelle pour l’observation des phénomènes humains, avaient accompagné sa parution, les plus aimables de contentant de trouver l’ouvrage « intéressant et agaçant ».
Dès lors, évoquer l’éventualité d’un « patrimoine européen », c’est retourner dans l’arène, ce que l’on fera ici certes sans hésiter et avec plaisir, mais aussi avec la précaution de la précision des termes et des faits. Car « patrimoine », de patri monere : « ce qui nous vient des pères » suggère l’existence d’une « famille », même si ce n’est qu’au titre de la métaphore, ce qui pourrait soulever des tempêtes. Alors, qu’en est-il ?
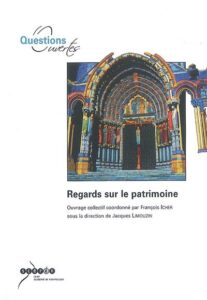 Il est certes aisé de rechercher, dans la conception la plus traditionnelle du « patrimoine »1 les espaces sur lesquels se sont étendus les artefacts de pierre (les édifices) ou de couleurs (les mosaïques, les peintures, etc.) qui « nous sont venus des pères ». Il est possible de dresser une carte de la diffusion de l’art des mosaïques romano-byzantines, une autre des symboles et éléments repris de l’art grec jusqu’aux frontons de nos tribunaux, d’autres encore des églises romanes, de l’art cistercien ou baroque, etc. La superposition de ces cartes définirait un espace dont l’européanité, réduite à ce type de patrimoine, serait d’ailleurs inégalement marquée2. Ce patrimoine là est, à la fois et chaque fois, d’une époque. Continûment remanié et restauré jusqu’à parfois le reconstruire ou le changer pierre à pierre, il n’est plus que rarement « d’époque », sinon par ses formes.
Il est certes aisé de rechercher, dans la conception la plus traditionnelle du « patrimoine »1 les espaces sur lesquels se sont étendus les artefacts de pierre (les édifices) ou de couleurs (les mosaïques, les peintures, etc.) qui « nous sont venus des pères ». Il est possible de dresser une carte de la diffusion de l’art des mosaïques romano-byzantines, une autre des symboles et éléments repris de l’art grec jusqu’aux frontons de nos tribunaux, d’autres encore des églises romanes, de l’art cistercien ou baroque, etc. La superposition de ces cartes définirait un espace dont l’européanité, réduite à ce type de patrimoine, serait d’ailleurs inégalement marquée2. Ce patrimoine là est, à la fois et chaque fois, d’une époque. Continûment remanié et restauré jusqu’à parfois le reconstruire ou le changer pierre à pierre, il n’est plus que rarement « d’époque », sinon par ses formes.
On sent bien toutefois que réduire l’Europe à un tel « patrimoine européen », c’est en faire un musée. Non un musée d’artefacts morts, puisqu’ils sont aujourd’hui toujours pratiqués, admirés, utilisés (souvent pour d’autres fins que celles pour lesquelles ils furent créés) et, pour tout dire, vécus, mais un musée quand même, dont on sent les vides et les manques. Il y a donc autre chose, et cet autre chose relève de l’immatériel.
 Il y a d’abord le legs des systèmes de pensée des mondes du passé, et qui se prolongent aujourd’hui. Le christianisme est né comme un judaïsme. Sortant de l’espace où se situaient son initiateur et, surtout, ceux qui nous l’ont raconté comme ils l’ont voulu et par qui il est seul connu, il s’est épanoui dans « l’empire gréco-romain »3. Ci-contre le Parthénon. Ses conceptions initiales, ont été largement remaniées par les catégories de la culture et de la philosophie grecques que les apologètes4 et les « Pères de l’Église » utilisaient parce qu’elles étaient les leurs et, surtout, celles de ceux qu’ils essayaient de convaincre. De plus, il s’est ensuite romanisé5 et surtout « impérialisé » quand, après Constantin, il est devenu la religion chérie du pouvoir et l’un de ses instruments6. Ce sont ces circonstances qui en ont fait un judéo-helléno-romano christianisme, avant que d’autres circonstances ne le fracturent entre Latins et Grecs du Moyen-âge, entre catholiques et protestants de l’âge moderne et entre modernistes et traditionnalistes d’aujourd’hui. Indubitablement l’Europe est chrétienne dans ce sens-là, pour autant que l’on accepte deux limites à cette affirmation : celle de l’historicisation perpétuelle et toujours en cours de tous les phénomènes humains et celle des bourgeonnements perpétuels de biens d’autres legs qui, eux, ne sont pas chrétiens même au sens composite qui vient d’être décrit ou ne le sont pas directement.
Il y a d’abord le legs des systèmes de pensée des mondes du passé, et qui se prolongent aujourd’hui. Le christianisme est né comme un judaïsme. Sortant de l’espace où se situaient son initiateur et, surtout, ceux qui nous l’ont raconté comme ils l’ont voulu et par qui il est seul connu, il s’est épanoui dans « l’empire gréco-romain »3. Ci-contre le Parthénon. Ses conceptions initiales, ont été largement remaniées par les catégories de la culture et de la philosophie grecques que les apologètes4 et les « Pères de l’Église » utilisaient parce qu’elles étaient les leurs et, surtout, celles de ceux qu’ils essayaient de convaincre. De plus, il s’est ensuite romanisé5 et surtout « impérialisé » quand, après Constantin, il est devenu la religion chérie du pouvoir et l’un de ses instruments6. Ce sont ces circonstances qui en ont fait un judéo-helléno-romano christianisme, avant que d’autres circonstances ne le fracturent entre Latins et Grecs du Moyen-âge, entre catholiques et protestants de l’âge moderne et entre modernistes et traditionnalistes d’aujourd’hui. Indubitablement l’Europe est chrétienne dans ce sens-là, pour autant que l’on accepte deux limites à cette affirmation : celle de l’historicisation perpétuelle et toujours en cours de tous les phénomènes humains et celle des bourgeonnements perpétuels de biens d’autres legs qui, eux, ne sont pas chrétiens même au sens composite qui vient d’être décrit ou ne le sont pas directement.
 Ainsi, tant la philosophie grecque que les conceptions romaines du droit et de l’État ont aussi donné forme à l’Europe, pas seulement en dialogue avec la religion venue de Jérusalem, à coté d’elle et parfois contre elle. Ci-contre la cathédrale de Chartres. Il y eut aussi le legs des cultures germaniques et slaves7. Il y eut aussi le travail des intellectuels, notamment universitaires. Ils inventèrent largement le débat, bien différent de la compilation et du commentaire. Ils déployèrent leurs conceptions, certes d’abord dans le contexte du christianisme (l’humanisme est originellement chrétien) mais aussi en dehors de lui, dans le développement des démarches critiques, des interrogations sur tout et qui, de Réforme en Renaissance, aboutirent à la philosophie des Lumières et à ses expressions politiques révolutionnaires. C’est de ces processus que sont sorties quelques unes des caractéristiques patrimoniales immatérielles de l’Europe, tardives sinon très tardives sur les marges de l’espace européen. Notamment la démocratie, conçue à la fois comme l’expression souveraine du suffrage populaire majoritaire, et sa limite par la transcendance nouvelle des Droits de l’Homme, arbitrée par une justice indépendante. C’est peu de dire que, face aux populismes et aux tentations illibérales, ce patrimoine tout récent est aussi aujourd’hui le plus fragile.
Ainsi, tant la philosophie grecque que les conceptions romaines du droit et de l’État ont aussi donné forme à l’Europe, pas seulement en dialogue avec la religion venue de Jérusalem, à coté d’elle et parfois contre elle. Ci-contre la cathédrale de Chartres. Il y eut aussi le legs des cultures germaniques et slaves7. Il y eut aussi le travail des intellectuels, notamment universitaires. Ils inventèrent largement le débat, bien différent de la compilation et du commentaire. Ils déployèrent leurs conceptions, certes d’abord dans le contexte du christianisme (l’humanisme est originellement chrétien) mais aussi en dehors de lui, dans le développement des démarches critiques, des interrogations sur tout et qui, de Réforme en Renaissance, aboutirent à la philosophie des Lumières et à ses expressions politiques révolutionnaires. C’est de ces processus que sont sorties quelques unes des caractéristiques patrimoniales immatérielles de l’Europe, tardives sinon très tardives sur les marges de l’espace européen. Notamment la démocratie, conçue à la fois comme l’expression souveraine du suffrage populaire majoritaire, et sa limite par la transcendance nouvelle des Droits de l’Homme, arbitrée par une justice indépendante. C’est peu de dire que, face aux populismes et aux tentations illibérales, ce patrimoine tout récent est aussi aujourd’hui le plus fragile.
Enfin, il y a sans doute d’autres caractéristiques plus ou moins spécifiques de l’Europe, ayant fondé sa fortune historique et qui sont devenues par certains aspects un patrimoine immatériel, même si elles sont partagés par bien d’autres cultures où civilisations, au point que l’ont peut y voir pour certaines, des traits plus globalement humains qu’européens.
 Jusqu’à la Renaissance, selon le modèle d’une vie humaine, le monde est réputé vieillir (mundus senescit) et se dégrader en avançant lentement vers la fin des temps. À partir de la Renaissance et en Europe, l’idée de progrès se substitue peu à peu à ce pessimisme de la Cité terrestre qui ne voyait d’avenir lumineux que dans la Cité Céleste. Ci-contre « La Naissance de Vénus » (Sandro Botticelli, vers 1485). Cette idée est plus délicate à concevoir, par exemple, dans les conceptions cycliques du temps qui furent celles des Amérindiens ou sont caractéristiques de l’hindouisme. Elle l’est ou l’était aussi dans la conception chinoise qui reposerait sur une « absolutisation de l’immanence »8, et qui serait historiquement dominée par une conception du monde ondulant entre périodes d’élévation et de succès qu’il faudrait saisir et de périodes de replis. La sagesse serait alors de s’y conformer.
Jusqu’à la Renaissance, selon le modèle d’une vie humaine, le monde est réputé vieillir (mundus senescit) et se dégrader en avançant lentement vers la fin des temps. À partir de la Renaissance et en Europe, l’idée de progrès se substitue peu à peu à ce pessimisme de la Cité terrestre qui ne voyait d’avenir lumineux que dans la Cité Céleste. Ci-contre « La Naissance de Vénus » (Sandro Botticelli, vers 1485). Cette idée est plus délicate à concevoir, par exemple, dans les conceptions cycliques du temps qui furent celles des Amérindiens ou sont caractéristiques de l’hindouisme. Elle l’est ou l’était aussi dans la conception chinoise qui reposerait sur une « absolutisation de l’immanence »8, et qui serait historiquement dominée par une conception du monde ondulant entre périodes d’élévation et de succès qu’il faudrait saisir et de périodes de replis. La sagesse serait alors de s’y conformer.
Dans la culture européenne, des figures ont peu à peu pris une singulière importance au point de jouer un rôle dans l’imaginaire de tous comme dans l’éducation des jeunes. La figure du héros d’abord gréco-romaine, puis chrétienne à travers celle du saint qui se substitue à elle, puis son retour dans des contextes contemporains9 est certes largement partagée ailleurs qu’en Europe, sous d’autres formes. Mais, les figures du marchand depuis le Moyen-âge, et, depuis les époques modernes et contemporaines, celles de l’entrepreneur, puis de l’ingénieur, tous nouveaux aventuriers, ont structuré une partie des imaginaires en même temps qu’elles contribuaient à un incroyable développement technologique et économique comme à la tentation, courte dans le temps mais d’immenses conséquences, de s’imposer au reste du monde par l’impérialisme colonial. De même, et depuis le XIXe siècle, la figure du militant social et politique, facteur lui aussi de progrès, cherche à équilibrer les autres.
Enfin, produit peut-être de l’humanisme, la plus nette différenciation qu’ailleurs de la culture « propre de l’Homme » et de la Nature « sauvage », la soumission de cette dernière à l’action humaine organisatrice de ce qui est perçu comme un chaos, sont sans doute aux fondements d’un rapport particulier au monde, que critiquent aujourd’hui les nouveaux pessimismes, au nom de l’écologisme.
o-O-o
Il serait périlleux, pour l’Europe pensée comme civilisation, sinon fallacieux de tirer de tout cela et de tout ce qui n’a pu être cité, l’idée d’une identité autre que plurielle et encore moins d’une essence. D’abord parce que cette Europe est le produit contemporain d’un empilement de circonstances historiques pluriséculaires dans lequel le hasard, au sens de Cournot, a joué un rôle déterminant. Ensuite parce que son rayonnement à partir de la fin de l’époque moderne puis les puissantes interrelations entre les groupes humains dans les dernières décennies ont des effets considérables sur chacun d’eux et, pour partie, d’homogénéisation. En fait, chacune des civilisations ou des cultures, selon le mot que l’on choisira, subit depuis longtemps des influences et accepte des emprunts réciproques. Aucune n’est aujourd’hui ce qu’elle était hier, ni ce qu’elle sera demain. En fait, contrairement aux pensées réductrices qui séduisent ceux qui ne voient de salut que dans un retour à des passés rêvés, chacune d’elle à une existence, non une essence.
Jacques LIMOUZIN, médiéviste, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie, doyen de l’inspection, académie de Montpellier, co-auteur de « Une histoire européenne de l’Europe » (Privat) et directeur de « Regards sur le patrimoine » (SCEREN).
1 Du moins… en Europe, où cette notion semble être née, d’ailleurs tardivement.
2 C’était l’une des intuitions de Charles-Olivier Carbonell.
3 Le mot est de Paul Veyne, soulignant la puissance culturelle de l’hellénisme dans le monde romain.
4 Les penseurs chrétiens des premiers siècles qui firent l’apologie de la nouvelle religion et répondirent aux nombreuses critiques des penseurs païens.
5 On évoque souvent beaucoup de la « christianisation » de l’empire romain, suivant en cela l’historiographie traditionnelle chrétienne reprise pour argent comptant par de distingués historiens laïques. Mais, c’est ne pas voir que le processus d’accommodement était réciproque et que les deux conceptions du monde qui se sont rencontrées ont été amenées à se changer l’une l’autre, pour n’en faire plus qu’une.
6 Au moins pour l’administration de l’empire et pour la légitimation du pouvoir.
7 Voir les caractères des contrats dans ces sociétés anciennes, leurs traditions juridiques et leur fortune postérieure. Voir la place de la femme, plus anticipatrice de notre modernité que dans les sociétés méditerranéennes. Et, peut-être même et sous réserve d’une réflexion plus approfondie, voir la conception ethnique de la nation qui, se combinant avec l’idée de souveraineté, a contribué à produire, pour le meilleur et pour le pire, cette originalité européenne qu’est l’Etat-nation du XIXe siècle.
8 Le mot est de François Jullien. Les conceptions de François JULLIEN (rééditées in La pensée Chinoise, Folio essais, GALLIMARD, 2019) ont été contestées par Jean-François BILLETER (Contre François Jullien, ALLIA, 2006).
9 Des héros de chaque nation à l’âge de chaque « roman national », par exemple, jusqu’aux « héros » sportifs plus ou moins nationalisés.